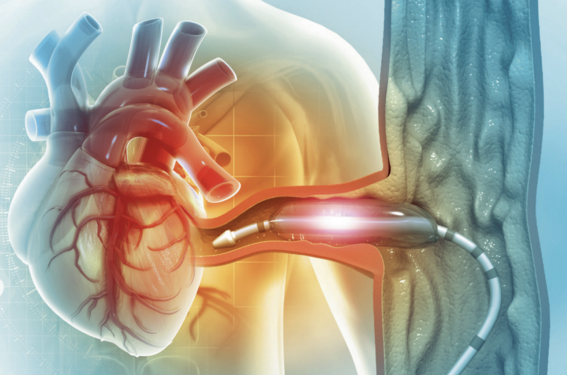Polémique
Publié le 30 mar 2025Lecture 6 min
Quelles FA ne pas ablater ?
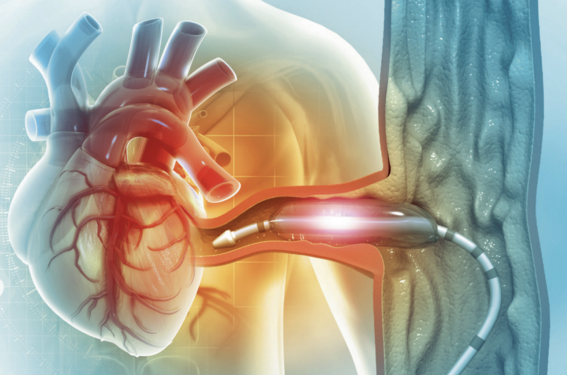
Le traitement de la fibrillation atriale (FA) repose sur des approches pharmacologiques et interventionnelles, parmi lesquelles figure l’ablation par cathéter. Cette dernière est devenue l’élément incontournable de la stratégie du contrôle du rythme dans la fibrillation atriale et, grâce aux évolutions techniques qui ont permis une meilleure efficacité, sa place a été encore renforcée puisque les dernières recommandations de l’ESC la positionne maintenant en première ligne, avec un niveau de recommandation IA dans les formes paroxystiques ou IIB dans les formes persistantes. Bien qu’efficace chez de nombreux patients, cette technique n’est pourtant pas sans limites et certaines conditions cliniques ou contextes spécifiques peuvent contre-indiquer cette procédure, la rendre inutile, impossible ou dangereuse. Dans d’autres situations ou profil de patients, la balance bénéfice/risque de l’ablation sera plus discutée, notamment en raison d’un taux élevé d’échecs présumés ou de récidive.
Les contre-indications
Situations cliniques particulières
On pourra facilement identifier certains profils qui ne doivent pas être ablatés en raison d’une contre-indication évidente, comme par exemple un thrombus au niveau de l’auricule gauche, une hyperthyroïdie clinique ou biologique, des épisodes de FA favorisés par la prise de toxiques, de drogues ou suite à une consommation aiguë, excessive d’alcool.
Incapacité à tolérer une anticoagulation prolongée
La procédure d’ablation a la particularité de cumuler à la fois un risque embolique (notamment d’AVC) et un risque hémorragique (épanchement péricardique, complications vasculaires, etc.). Les patients ayant bénéficié d’une ablation de FA doivent pouvoir maintenir un traitement anticoagulant au moins 2 mois après la procédure, qui sera poursuivi ou non au-delà en fonction de leur score CHA2DS2-VA. Les patients atteints de coagulopathies sévères, présentant des antécédents de saignements majeurs non contrôlés, ceux devant se faire opérer peu de temps après le geste d’ablation ou refusant catégoriquement l’anticoagulation, sont de facto des candidats inappropriés à l’ablation.
Incapacité technique ou anomalies anatomiques
Chez certains patients, une obstruction sévère des voies d’accès (par exemple, thrombose de la veine fémorale ou iliaque), des malformations congénitales complexes du cœur ou des anomalies des veines pulmonaires peuvent rendre l’accès difficile ou impossible.
Grossesse ou désir de grossesse
La grossesse constitue une contre-indication temporaire à l’ablation en raison des risques liés à l’exposition aux rayonnements et à l’anticoagulation. Pour les femmes en âge de procréer, la planification de l’intervention doit être discutée en fonction de leurs projets.
Ablater pour pouvoir arrêter les anticoagulants
Les recommandations précisent clairement que l’ablation ne doit pas être proposée pour permettre l’arrêt du traitement anticoagulant chez les patients dont le score CHA2DS2-VA justifie l’anticoagulation.
Les indications à discuter
Ces situations exigent une évaluation précise des risques et des bénéfices, avec une approche individualisée compte tenu du faible taux de succès attendu.
Patients asymtomatiques
Ces patients ne ressentiront pas de bénéfice clinique mais la diminution de la charge atriale grâce à l’ablation peut améliorer leur pronostic. La réalisation préalable d’un choc électrique chez ce type de patients est recommandée (grade IIA) pour dépister les « faux » asymptomatiques et juger de l’amélioration clinique éventuelle en rythme sinusal.
Âge avancé
Bien qu’un âge élevé seul (généralement > 75 ans dans les études) ne soit pas une contre-indication au geste, avec un taux de récidive souvent identique aux patients les plus jeunes, les patients âgés présentent davantage de comorbidités, augmentant ainsi les risques de complications (+ 32 % sur les complications majeures, + 68 % sur les AVC)(1). Les recommandations suggèrent d’évaluer soigneusement ces patients avant de proposer une ablation : un score de fragilité a été développé(2), permettant de prédire la mortalité à J30, la durée de séjour et le taux de réhospitalisation, et ainsi de mieux évaluer le bénéfice/risque de la procédure.
FA persistante de longue durée
L’ablation est généralement moins efficace dans les formes persistantes de FA, et les dernières études à très long terme de l’ablation(3) montrent des résultats encore insuffisants dans les formes persistantes de longue durée (maintien du rythme sinusal de seulement 30 % à 5 ans, 18 % à 10 ans et 3 % à 15 ans (vs 68 %, 56 % et 48 % dans les FA paroxystiques), avec peu d’amélioration malgré les progrès techniques. À partir des données de l’étude EARNEST-PVI(4), une arythmie évoluant sous forme persistante depuis plus de 2,4 ans laisse présager d’un taux de récurrence très élevé, et devrait faire renoncer à une ablation (figure).
Figure. Risque de récurrence de la fibrillation atriale en fonction de son ancienneté.
Dilatation importante de l’oreillette gauche (OG)
L’impact de la dilatation de l’OG sur le taux de récidive est clairement retrouvé dans de nombreuses études. Par exemple, dans l’étude française Party-PVI(5) s’intéressant aux récidives de FA après une première procédure d’ablation, seule la taille de l’OG ressort comme facteur prédictif de récurrence. Ainsi, si l’oreillette gauche est dilatée à plus de 48 ml/m2, le taux de récurrence sera deux fois supérieur à celui des patients avec une OG < 34 ml/m2. D’autres études(6) retiennent plutôt le seuil de 60 ml/m2 pour considérer un taux de succès trop faible.
Fibrose de l’oreillette gauche
L’évaluation par IRM, avec un logiciel dédié(7), sur un suivi à 5 ans, a permis de stratifier la fibrose en quatre stades (score de Utah) avec un taux très élevé de récidive dans le stade IV. Son utilisation en pratique courante est peu accessible et la principale difficulté reste de pouvoir quantifier cette fibrose avant le geste.
Apnées du sommeil
Un SAOS sévère (IAH > 30) non appareillé est un facteur prédictif d’échec de l’ablation (jusqu’à 70 % de récidive à 1 an selon les études).
Les métaanalyses d’études observationnelles retrouvent une diminution du risque de récurrence grâce au traitement par orthèse d’avancée mandibulaire ou par pression positive continue (PPC) mais, pour le moment, aucune étude randomisée n’a pu montrer de bénéfice de la PPC(8).
Insuffisance cardiaque sévère
Dans les métaanalyses(9) s’intéressant aux insuffisants cardiaques avec fibrillation atriale ou dans CASTLE-AF, l’ablation est supérieure au traitement médical, que ce soit les récidives de FA ou la mortalité, mais ce bénéfice n’est plus retrouvé pour les sous-groupes les plus sévères (classe III et IV NYHA ou FEVG < 25 %). Toutefois dans l’étude CASTLE-HTx, chez les patients en insuffisance cardiaque avancée présentant une FA symptomatique, l’ablation était bénéfique pour réduire le critère de jugement composite comprenant mortalité toutes causes, implantation d’un dispositif d’assistance ventriculaire gauche ou transplantation cardiaque en urgence.
Obésité sévère
Les patients obèses (avec un IMC > 35 kg/m²) présentent un risque nettement accru de récidive après ablation, en raison de l’inflammation chronique et des altérations structurelles de l’oreillette gauche, mais également de complications plus fréquentes(10). L’ESC recommande une optimisation pondérale avant de proposer la procédure. Il n’y a en revanche pas d’amélioration de la charge atriale postablation si la perte de poids est obtenue après la procédure d’ablation(11).
CONCLUSION
La prise en charge optimale de la fibrillation atriale repose sur une approche personnalisée où l’ablation a pris une place centrale dans la stratégie du contrôle du rythme, mais elle n’est pas adaptée à tous les patients. Une identification claire des contreindications, qu’elles soient absolues ou relatives, est essentielle pour garantir des résultats optimaux et minimiser les risques. Aucun critère isolé ne suffit à récuser une procédure d’ablation, mais une arythmie persistante ancienne de plus de 2 ans, une oreillette gauche dilatée à plus de 48 ml/m2, une fibrose importante de l’oreillette gauche, un âge supérieur à 75 ans avec un terrain fragile, une obésité sévère ou une insuffisance cardiaque sévère mal contrôlée sont des critères prédictifs d’échec de la procédure. L’apport de l’intelligence artificielle, en intégrant toutes les données cliniques et paracliniques du patient, permettra sûrement de mieux prédire le taux de succès à titre individuel.
Attention, pour des raisons réglementaires ce site est réservé aux professionnels de santé.
pour voir la suite, inscrivez-vous gratuitement.
Si vous êtes déjà inscrit,
connectez vous :
Si vous n'êtes pas encore inscrit au site,
inscrivez-vous gratuitement :