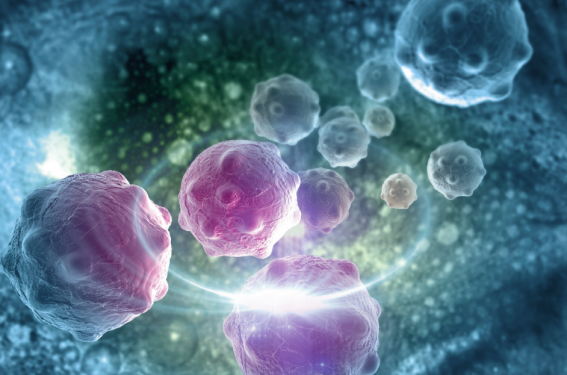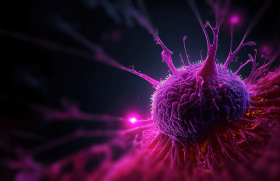Cardio-oncologie
Publié le 31 mar 2025Lecture 6 min
L’essentiel de la cardio-oncologie - Retour sur les principales publications de 2024
Joachim ALEXANDRE, Charles DOLLADILLE, Normandie Université, UNICAEN, CHU de Caen-Normandie, filière de cardio-oncologie PICARO, service de pharmacologie, U1086 INSERM « ANTICIPE », Caen
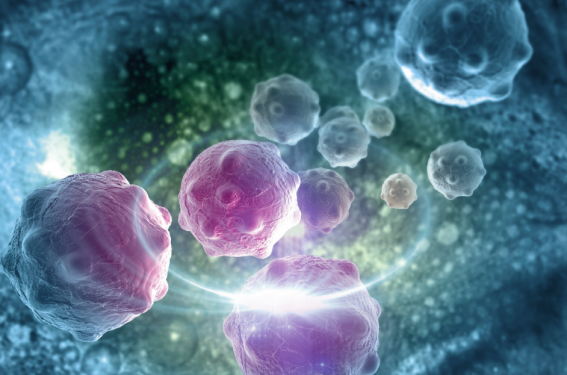
Depuis les années 1990, il y a eu une diminution constante de la mortalité liée au cancer, accompagnée d’une augmentation régulière du nombre de survivants du cancer. Dans ce contexte, les effets indésirables associés aux thérapeutiques anticancéreuses deviennent un enjeu majeur. La gestion des cardiotoxicités liées aux traitements anticancéreux a un impact considérable sur le type et la durée des thérapies anticancéreuses que les patients peuvent recevoir, ainsi que sur la morbi-mortalité générale. En 2019, 11 % des patients ayant survécu à leur cancer sont morts d’une maladie cardiovasculaire soulignant l’importante nécessité de poursuivre le développement de la cardiooncologie(1). Une gestion efficace des patients atteints à la fois de cancer et de maladies cardiovasculaires nécessite l’intérêt et l’expertise uniques des acteurs du soin, ce qui a conduit à la formation d’une nouvelle discipline : la cardio-oncologie.
Le risque de cardiotoxicité lié aux traitements anticancéreux est une variable dynamique (figure 1), et ce risque évolue le long d’un continuum débutant au moment du diagnostic de cancer actif, passant par une ou plusieurs lignes de thérapies anticancéreuses et allant, dans le meilleur des cas, jusqu’à la rémission voir la guérison (patients survivants du cancer)(2). Ainsi, se dégagent trois périodes principales pour les patients suivis en cardio-oncologie dynamique (figure 1) : la prévention de la cardiotoxicité avant l’introduction de la thérapie anticancéreuse, la surveillance cardiovasculaire pendant la thérapie anticancéreuse associée à la détection précoce et à la gestion des cardiotoxicités, et la prévention de la cardiotoxicité chez les survivants du cancer après la fin de la thérapie anticancéreuse.
Figure 1. Risque de cardiotoxicité des traitements anticancéreux.
Nous allons survoler dans cet article les principales publications de 2024 concernant chacune de ces 3 périodes intéressant un patient suivi en cardio-oncologie.
Prévention de la cardiotoxicité avant l’introduction du traitement anticancéreux
L’évaluation cardio-oncologique précédant l’introduction d’un anticancéreux cardiotoxique est une étape primordiale permettant de stratifier le risque du patient d’expérimenter une toxicité cardiovasculaire au cours du traitement. Les recommandations de 2022 de cardiooncologie émises par l’ESC préconisent l’utilisation des scores HFA-ICOS (recommandation de classe IIa, C), mais ces derniers n’avaient pas tous été complètement validés lors de la publication de ces recommandations(2). La publication récente issue du registre espagnol CARDIOTOX (NCT02039622) a permis de valider le score HFA-ICOS pour stratifier le risque de faire une cardiotoxicité aux anthracyclines(3). L’analyse a inclus 1 066 patients (âge moyen 54 ± 14 ans ; 81,9 % de femmes ; 24,5 % ≥ 65 ans). Selon les critères HFA-ICOS, 571 patients (53,6 %) ont été classés comme à faible risque, 333 (31,2 %) comme à risque modéré, 152 (14,3 %) comme à haut risque et 10 (0,9 %) comme à très haut risque de développer une cardiotoxicité en cours de traitement par anthracyclines. Le suivi médian était de 54,8 mois (intervalle interquartile 24,6 - 81,8). Un total de 197 patients (18,4 %) sont décédés, et 718 (67,3 %) ont développé une dysfonction cardiaque (symptomatique : n = 45 ; asymptomatique modérée à sévère : n = 4 ; et asymptomatique légère : n = 649 ; selon les définitions des cardiotoxicités proposées dans les recommandations ESC(2)). Les taux d’incidence des dysfonctions cardiaques symptomatiques ou modérées à sévères, ainsi que la mortalité toutes causes, étaient positivement et significativement associés avec le score HFA-ICOS calculé en baseline confirmant l’intérêt de réaliser ces scores prédictifs. Malgré ces résultats probants concernant les patients exposés aux anthracyclines, il reste tout de même difficile pour les autres anticancéreux d’identifier, via les scores existants et avec une bonne sensibilité et une bonne spécificité, les patients qui vont expérimenter une cardiotoxicité en cours de traitement anticancéreux. Dans l’avenir, nos espoirs reposent largement sur l’utilisation de l’intelligence artificielle appliquée à de grandes bases de données.
Un autre point majeur de cette période précédant l’introduction des traitements anticancéreux est, en cas de patients identifiés comme étant à haut ou très haut risque de développer une cardiotoxicité, le souhait de réduire ce risque grâce à l’utilisation de médicaments cardioprotecteurs. Malheureusement, tout comme l’ensemble des études précédentes ayant testé les IEC dans ce contexte (mais aussi les ARA2 et les bêtabloquants), une nouvelle étude ayant évalué l’énalapril (étude PROACT) est malheureusement elle aussi revenue négative(4). Désormais, seuls les inhibiteurs de SGLT2, pour lesquels des données encourageantes commencent à s’accumuler, mais non suffisamment robustes pour une utilisation en soins courants à l’heure actuelle, peuvent peut-être prétendre à être utilisés comme des cardioprotecteurs dans ce contexte. Une dernière étude publiée fin 2024, mais de faible niveau de preuve, a en effet montré un moindre taux de cardiotoxicités chez les patientes traitées par anthracyclines pour un cancer du sein et recevant de l’empagliflozine(5). En l’absence de stratégie préventive spécifique des cardiotoxicités, l’identification et l’optimisation des facteurs de risque cardiovasculaires et l’activité physique restent plus que jamais de rigueur avant de débuter des anticancéreux cardiotoxiques.
Surveillance cardiovasculaire pendant le traitement du cancer associée à une détection précoce et à une gestion optimale des événements cardiotoxiques. Une fois les traitements anticancéreux débutés, il est primordial de mettre en place la surveillance cardiovasculaire, avec un rythme adapté au risque de cardiotoxicité évalué en préthérapeutique, comme préconisé dans les recommandations ESC de cardio-oncologie(2). L’objectif principal est alors de détecter le plus précocement possible la survenue d’une cardiotoxicité.
Le strain longitudinal global du ventricule gauche est depuis longtemps considéré comme un possible marqueur précoce, plus précoce que la baisse de FEVG, de la survenue d’une dysfonction cardiaque imputable aux anticancéreux et en particulier aux anthracyclines. Il était donc séduisant d’évaluer si l’introduction d’un traitement cardioprotecteur associant bêtabloquant et IEC/ARAII en cas d’altération de ce strain sous anthracyclines était associée à une moindre diminution de la FEVG comparativement à un groupe contrôle ne recevant pas de traitement cardioprotecteur(6). Cette étude est revenue positive avec une différence de baisse de FEVG statistiquement plus faible dans le groupe de patients bénéficiant d’une cardioprotection que dans le groupe contrôle, mais cette différence en valeur absolue (Δ2,5 ± 5,4 % vs Δ-5,6 ± 5,9 %, p = 0,009) interroge quant à sa pertinence clinique.
Les myocardites immunomédiées comptent parmi les événements cardiotoxiques les plus sévères avec un taux de mortalité globale actuellement aux alentours de 20-30 %. Le traitement de première in tention repose sur une corticothérapie précoce à forte dose initialement par voie IV (méthyl prednisolone 500- 1 000 mg/j pendant au moins 3 jours) suivie d’un relais rapide per os en cas de bonne réponse initiale, selon les recommandations ESC de 2022(2). Des interrogations ont rapidement été soulevées quant à l’utilisation de fortes doses de corticoïdes ainsi qu’à la durée de cette corticothérapie chez des patients porteurs d’un cancer actif (quelles répercussions oncologiques ?). Une étude rétrospective récente incluant 475 patients a essayé de répondre à ces interrogations(7). Le fait de recevoir des corticoïdes (indépendamment de la dose et de la durée) pour un effet indésirable immuno-médié (tous types, pas seulement des myocardites) était associé à une moins bonne réponse oncologique évaluée à 30 et 90 jours. Cette moins bonne réponse oncologique était d’autant plus marquée que les doses de corticoïdes étaient élevées. Il convient donc de, certes, diagnostiquer et introduire rapidement des corticoïdes en cas de myocardite immuno-médiée, mais également de savoir se limiter à la dose minimale efficace et de les interrompre le plus rapidement possible après décroissance.
Prévention de la cardiotoxicité chez les survivants du cancer après la fin du traitement contre le cancer
La dernière période pour les patients ayant survécu à leur cancer est celle de la prévention à long terme (au-delà de la période d’exposition aux anticancéreux) de la survenue d’une cardiotoxicité. Le risque de cardiotoxicité de ces patients doit être réévalué 1 an après la fin des traitements actifs, puis à 5 ans. Tout comme durant la phase active du cancer, plusieurs études ont évalué l’efficacité d’une stratégie de prévention primaire par des médicaments cardioprotecteurs chez les survivants du cancer, au-delà de la phase active. Malheureusement, les résultats de ces études sont négatifs avec récemment une absence de réduction des dysfonctions cardiaques (mesurées par des paramètres échographiques) par le carvédilol chez les patients adultes traités par anthracyclines durant l’enfance pour un sarcome ou un lymphome(8).
En l’absence de stratégie préventive spécifique des cardiotoxicités chez ces patients ayant survécu à leur cancer, l’identification et l’optimisation des facteurs de risque cardiovasculaires et l’activité physique restent plus que jamais de rigueur.
EN PRATIQUE
• La cardio-oncologie est une sous-spécialité encore jeune, mais en constante évolution.
• L’année 2024 a produit des données scientifiques riches nous permettant de toujours tendre vers une réduction des événements cardiovasculaires chez les patients présentant un cancer actif ou ayant survécu à leur cancer.
• L’identification des patients à risque, la quête d’une prévention primaire efficace de la cardiotoxicité via des interventions spécifiques et une amélioration de la prise en charge des cardiotoxicités tout en permettant la poursuite des traitements anticancéreux les plus adaptés restent les fondements de la cardio-oncologie.
Liens d’intérêts
JA : L’auteur déclare avoir des liens d’intérêts avec Biotronik, Amgen, BMS, Pfizer, Boerhinger Ingelheim, Bayer, AstraZeneca, Janssen, Servier, Novartis, COPilot, Léo Pharma, Pierre Fabre, Eisai en dehors de ce travail présenté.
CD : L’auteur déclare avoir des liens d’intérêts avec BMS, Pfizer, COPilot, Bioserenity en dehors de ce travail.
Attention, pour des raisons réglementaires ce site est réservé aux professionnels de santé.
pour voir la suite, inscrivez-vous gratuitement.
Si vous êtes déjà inscrit,
connectez vous :
Si vous n'êtes pas encore inscrit au site,
inscrivez-vous gratuitement :