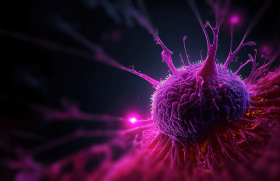Cardio-oncologie
Publié le 24 fév 2025Lecture 4 min
Rôle du sacubitril-valsartan dans la prévention de la cardiotoxicité chez les patients à haut risque traités par anthracyclines - Résultats du SARAH Trial
Dorra M’BAREK RABOUDI, Kamel GARMAN, Emmanuel MESSAS, Unité de cardio-oncologie, service de médecine vasculaire ; Hôpital européen Georges-Pompidou, AP-HP, Paris

La cardiotoxicité induite par les anthracyclines constitue une complication grave, avec un risque de dysfonction ventriculaire gauche, dose-dépendant, allant de 10 à 65 % des cas(1). Malgré les nombreux efforts fournis, nous n’avons encore aucun consensus clair quant à la meilleure stratégie de prévention de cette cardiotoxicité. Plusieurs pistes ont été étudiées : modalités de perfusion en continu, formes liposomales des anthracyclines, utilisation de la dexrazoxane, ou encore certains traitements, tels que les bêtabloquants, les inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC), les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine 2 (ARA2)(2), ainsi que les statines(3). Les effets sur cette cardiotoxicité du sacubitril-valsartan, un traitement couramment utilisé dans l’insuffisance cardiaque systolique, ne sont pas encore bien connus. Des études expérimentales suggèrent une cardioprotection potentielle. Le SARAH Trial explore l’efficacité de ce traitement pour prévenir la toxicité cardiaque chez des patients à haut risque recevant une chimiothérapie à base d’anthracyclines
Méthodologie
L’étude SARAH est un essai monocentrique, prospectif, randomisé, mené en double aveugle et contrôlé par placebo, de mars 2022 à août 2024.
Population étudiée
L’étude a randomisé 114 patients adultes (> 18 ans), traités par anthracyclines pour un cancer, et qui sont à haut risque de cardiotoxicité, défini par une augmentation de la troponine I hypersensible (hs-TnI) au-delà du 99e percentile au décours de la chimiothérapie.
Critères d’exclusion
Ont été exclus les patients ayant déjà reçu un traitement antérieur par chimio- ou radiothérapie, ceux avec des cardiopathies pré - existantes (cardiomyopathies, coronaropathies, valvulopathies moyennes à sévères), les patients ayant une hypotension artérielle (PAS < 100 mmHg), ceux déjà sous bêtabloquants, IEC ou ARA2, ceux ayant une contre-indication au sacubutril-valsartan (angio-œdème, sténose de l’artère rénale, débit de filtration glomérulaire < 30 mL/min/m2, hyperkaliémie, grossesse) et ceux chez qui il est impossible d’évaluer la fonction ventriculaire gauche.
Design
Les participants ont été randomisés dans un rapport 1:1 pour recevoir soit le sacubitril-valsartan (dose cible de 97/103 mg deux fois par jour), soit un placebo, sur une durée de 24 semaines (figure 1). L’évaluation s’est basée sur la clinique, la biologie (dosage des biomarqueurs cardiaques) et l’imagerie (échocardiographie et IRM cardiaque).
Figure 1. Design de l’étude, un essai clinique randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo.
Critères de jugement
Principal : incidence des patients pré sentant une réduction > 15 % du strain global longitudinal (SGL) du ventricule gauche (VG) après 24 semaines de traitement par sacubitril-valsartan (ARNi) ou placebo.
Secondaires :
– diminution de > 10 % de la fraction d’éjection ventriculaire gauche (FEVG) avec une valeur finale < 53 % ;
– variations des biomarqueurs (augmentation de la troponine US I et du NT-proBNP) et des paramètres d’imagerie en échocardiographie et en IRM (variations des dimensions ou fonctions ventriculaires, de la masse VG, anomalies de la fonction diastolique, du volume extracellulaire/fibrose interstitielle) ;
– survenue d’événements cliniques (insuffisance cardiaque, hospitalisation, décès ou transplantation cardiaque) ;
– survenue d’événements indésirables au cours du suivi à 6 mois.
Résultats principaux
Caractéristiques des participants
Parmi les patients, 90 % étaient des femmes, la plupart traitées pour un cancer du sein (80 %), présentant au moins une comorbidité (64 %). L’âge moyen était de 51,7 ± 11,6 ans. Le SGL de base était de -20,1 % (-15,5 % à -29 %) et la FEVG de base de 64 % (53,1 % à 79,2 %). La dose cumulée médiane d’anthracyclines était de 240 mg/m2.
Critère de jugement principal (tableau 1) : Réduction du SGL > 15 % : 7,1 % dans le groupe ARNi vs 25 % dans le groupe placebo (RR 0,23 ; IC95% [0,07 à 0,75] ; p < 0,015). Ceci correspond à une réduction du risque relatif de 77 % sous ARNi, indépendamment des autres facteurs de risque (NNT = 5,59).
Critères de jugements secondaires :
– SGL : il y a eu une amélioration du SGL de 2,5 % dans le groupe ARNi, contre une baisse de 7,6 % dans le groupe placebo (p < 0,001) (tableau 2) ;
– FEVG : il y a eu une augmentation de la FEVG mesurée en IRM de 0,19 % dans le groupe ARNi vs une diminution de 3,47 % dans le groupe placebo (p = 0,01).
L’évaluation de la FEVG en échocardiographie n’a pas montré de différence significative entre les 2 groupes (tableau 3) ;
– des variations significatives des volumes télédiastolique et télésystolique du VG ont été notées, en faveur du groupe ARNi ;
– événements cliniques : il n’y a pas de différence significative entre les 2 groupes ;
– effets secondaires : hypotension artérielle et hyperkaliémie ont été rapportées plus fréquemment dans le groupe ARNi, sans effets indésirables graves nécessitant l’arrêt du traitement.
Discussion et implications cliniques
Les résultats du SARAH Trial mettent en évidence le potentiel cardioprotecteur du sacubitrilvalsartan chez des patients à haut risque de cardiotoxicité traités par anthracyclines.
Forces de l’étude
• Bonne conception méthodologique (randomisée, double aveugle).
• Utilisation de biomarqueurs et de différentes techniques d’imagerie pour un suivi précis.
Limites
• Étude monocentrique avec une taille d’échantillon réduite, bien que statistiquement robuste.
• Durée de suivi de 24 semaines, insuffisante pour évaluer les effets à long terme.
EN PRATIQUE
• L’étude SARAH est la première étude à démontrer une réduction significative de la cardiotoxicité induite par les anthracyclines grâce au sacubitril-valsartan chez les patients à haut risque.
• La dysfonction VG évaluée par la baisse de plus de 15 % du SGL était significativement plus faible dans le groupe recevant le sacubitril-valsartan par rapport au groupe placebo.
• Ces résultats nécessitent toutefois une validation par des essais multicentriques, plus larges avec un suivi plus prolongé, afin de confirmer la durabilité des résultats et leur impact clinique.
• La mise en œuvre clinique pourrait transformer la prise en charge des patients oncologiques à haut risque de cardiotoxicité.
Liens d’intérêt : aucun.
Attention, pour des raisons réglementaires ce site est réservé aux professionnels de santé.
pour voir la suite, inscrivez-vous gratuitement.
Si vous êtes déjà inscrit,
connectez vous :
Si vous n'êtes pas encore inscrit au site,
inscrivez-vous gratuitement :